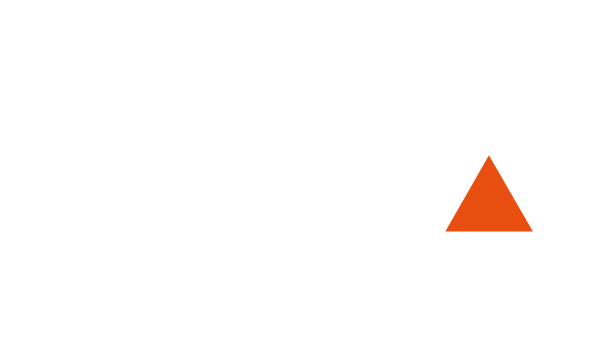La formation à l’UGA : l’accessibilité comme ambition, la flexibilité comme moyen
Formation, Innovation pédagogique, Orientation et insertion
le 4 avril 2023

David Dechenaud et Marc Oddon, vice-présidents de la formation et de la formation continue à l'Université Grenoble Alpes, nous expliquent comment l’UGA s’approprie la loi de réforme de la formation professionnelle de 2018 qui vise à accompagner les changements économiques, sociétaux et favoriser l’insertion professionnelle.
Ce vaste chantier en cours implique de revoir les modalités de construction et de conception de nos formations pour les inscrire dans une logique de professionnalisation progressive adaptée aux besoins en compétences du marché du travail. C’est tout l’enjeu du projet Flexi-TLV (projet PIA 3 Nouveaux Cursus Universitaires) mis en place à l’UGA que de répondre à ces défis.
Comment l’UGA s’est-elle emparée de la loi de septembre 2018 et quelle conséquence la réforme entraîne-t-elle sur son organisation ?
David Dechenaud : Les diplômes de l’université sont souvent associés à une image très académique. Derrière le titre universitaire, les compétences n’étaient pas absentes mais elles étaient peu visibles. Et l’université semblait plus préoccupée de l’architecture interne de ses diplômes (UE, semestres,…) que des efforts à déployer pour informer nos publics des compétences professionnelles visées par la formation. La loi de 2018 appelle une manière différente de communiquer sur nos diplômes où les compétences associées doivent être plus lisibles. Leurs certifications exigent aussi de nouvelles méthodes d’évaluation, ambitieuses mais chronophages. Il faut donc repenser nos schémas.Nous visons l’excellence d’une université de rang mondial et nous devons avoir l’ambition de suivre les standards européens. La mobilité de nos étudiants à l'international pose également la question de la portabilité des compétences : le système ECTS a vieilli et n’est compris que par les universitaires. Il nous faut engager un Bologne 2.0. pour une approche qui parle plus aux employeurs qui eux, raisonnent davantage en termes de compétences.
Marc Oddon : Sur le fond, la loi invite l’université à ouvrir son offre à de nouveaux publics, à mieux en considérer les besoins spécifiques, en un mot à prendre en compte l’évolution de la demande, qu’elle soit celle des employeurs, celle des étudiants, celle des stagiaires de la formation professionnelle et plus largement celle de tous les usagers potentiels de l’université. L’accessibilité est ainsi au cœur de l’ambition de l’Université Grenoble Alpes, et la flexibilisation de son offre en est un des leviers.
Qu’entendez-vous par flexibilité de son offre ?
MO : Nous n’avons pas de définition propre de cette notion à l’UGA, nous nous référons ici aux travaux sur le sujet qui globalement veulent qu’une formation soit dite flexible si elle laisse à l’apprenant une liberté de choix organisationnelle sur le rythme, la durée et la spatialisation du parcours, une liberté de choix pédagogique par l’individualisation des objectifs et des modes d’apprentissage, ou une liberté de choix quant aux modalités d’accompagnement.DD : La flexibilité, c’est la capacité de l’offre à répondre à des besoins variés et des contraintes variées. Il y a plusieurs typologies d’étudiants. Et nous ne répondons centralement qu’à un type idéal, celui de l’étudiant entièrement disponible pour engager une formation initiale. Nous progressons par de nouvelles solutions flexibles exemplaires, en STAPS par exemple, qui travaille efficacement à rendre flexible son offre pour répondre aux exigences d’accompagnement des publics spécifiques, solutions qui finalement profitent potentiellement à tous.
En matière d’enseignement hybride, ou entièrement à distance par exemple, se pose la question de la qualité de nos supports d’enseignement : entre le pdf mis en ligne et le cours scénarisé enrichi de séquences animées, nous devons progresser vers des modèles ajustés aux différents usages et répondant aux standards d’aujourd’hui.
Nous devons également prendre en compte en formation initiale l’engagement étudiant dans d’autres activités formatives, non académiques, mais contribuant à la professionnalisation des étudiants. Nous devons également banaliser la possibilité de réaliser une année de césure et travailler à assouplir le calendrier universitaire, permettre d’engager un semestre 1 en début de semestre 2 par exemple.
Cette souplesse impacte fortement les enseignants, soit sur le plan horaire, soit sur le plan technique et pédagogique. Et si on considère l’ampleur des effectifs de notre université, l'exigence de souplesse interroge notre capacité de réponse mais je crois que l’on doit mener une mission de service public en capacité de s’adapter pour que la souplesse ne devienne pas l’apanage de l’offre concurrentielle…
Quelle conséquence cela a-t-il sur l’organisation pédagogique et administrative de l’université ?
MO : Il s’agit d’un chantier qui reste encore à animer. Nous devons construire notre propre ambition et organiser notre propre modèle. La loi est finalement assez ductile. Elle a fixé la perspective globale et s’est accompagnée de la création d’institutions et d’outils originaux - tels que France Compétences et les répertoires nationaux de certifications par exemple - mais elle laisse aux établissements le soin de se positionner dans ce paysage profondément modifié.Nous devons prendre garde à accompagner nos usagers dans la construction d’un parcours cohérent, sécurisant sur le plan de son utilité professionnelle. La liberté de l’usager augmente et avec elle augmentent notre responsabilité et notre devoir de vigilance… On comprendra la centralité et les exigences nouvelles qui s’imposent aux agents des services d’orientation appelés à devenir des architectes de parcours en transversalité avec les conseillers de formation continue…
DD : Notre cadre universitaire ne doit pas être totalement désincarné et doit conserver ce qui en fait la chair substantielle mais il doit gagner en souplesse. Les blocs permettent de rentrer par compétences sur les diplômes : il convient de travailler sur la normalisation, et donner la capacité à nos scolarités de garder une traçabilité des parcours.
Un chef d’entreprise peut décrire sa fiche de poste directement par le bloc de compétence visé. Et les compétences que l’on délivre doivent être celles qui sont attendues par le marché du travail. L’université doit se mettre en capacité de répondre à ce besoin et de communiquer son offre sur la base d’un langage compatible avec le modèle ECTS et avec le modèle d’expression des compétences.
Les logiques de fragmentation des diplômes en blocs de compétences peuvent permettre de mieux respecter les rythmes d’apprentissage et les disponibilités de nos usagers, il est impératif de veiller à ne pas affaiblir nos diplômes en tant que formation non seulement professionnelle mais humaniste et citoyenne.
La formation universitaire dépasse les exigences de compétences nécessaires aujourd’hui en préparant également nos diplômés à celles qui seront attendues demain, en influençant par la recherche les métiers de demain et donc les compétences qui seront alors attendues par les employeurs. C’est cet adossement à la recherche qui distingue l’université et ses diplômes des autres certificateurs de formations professionnelles.
Vous évoquez la nécessité d’ouvrir un chantier spécifique pour préciser l’ambition de l’université en ces matières et pour penser une organisation adaptée à ces nouvelles exigences : comment entendez-vous vous y prendre ?
MO : Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Flexi-TLV (Formation flexible tout au long de la vie, NCU Nouveaux Cursus à l’université, PIA3, ANR), nous entendons mobiliser les services administratifs des composantes dans une cellule “Réflexion & Développement” pour imaginer et développer les solutions dont nous avons aujourd’hui besoin. L’inscription sur blocs de compétences, les outils numériques de suivi des parcours de formation, la certification de compétences sur des enseignements en auto-apprentissage, les possibilités de support à l’évaluation qu’apporte l’intelligence artificielle sont par exemple des sujets à aborder.La diffusion prochaine du Rome 4.0 et le renseignement systématique, exigé par le Ministère du passeport de formation et de compétences de nos étudiants et stagiaires vont dans ce sens.
Mais l’administration n’est pas le seul acteur de l’université à être interrogée : trois ans après le lancement du projet Flexi-TLV, les conditions de sa pleine réussite apparaissent notamment liées au portage politique de son ambition, qui appelle un véritable changement de paradigme dans la façon de penser et de construire l’offre de formation de l’université à son plus haut niveau (NDLR : il s’agit d’une des conclusions du rapport d’évaluation externe du projet Flexi-TLV).
DD : Réussir cette évolution de l’université tient ainsi à la capacité de l’établissement à en faire partager l’enjeu et à en assurer l’appropriation par tous les acteurs, corps enseignant, directions administratives, apprenants. L’acculturation des collègues est nécessaire. Penser compétences et parcours de formation doit dépasser les cloisonnements institutionnels et les périmètres des marques. C’est une force d’avoir des acteurs publics qui visent la complémentarité et la cohérence pour répondre ensemble à la diversité des besoins exprimés par la société et ses acteurs socioéconomiques.
MO : Le congrès national organisé avec la Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance (FIED) à Grenoble le 28 mars dernier a contribué à faire connaître les pratiques actuelles, questionner leurs évolutions et penser l'université de demain. Le sur mesure accessible à tous ? Trois dimensions de cette thématique ont été abordées à travers des conférences, ateliers et partages d'expériences.
DD : Un travail reste notamment à réaliser en lien avec les professionnels ainsi qu’avec nos partenaires des lycées. Nous avons besoin de construire des éléments de langage commun pour donner du sens à l’idée d’éducation et de formation tout au long de la vie.
Publié le 4 avril 2023
Mis à jour le 27 avril 2023
Mis à jour le 27 avril 2023